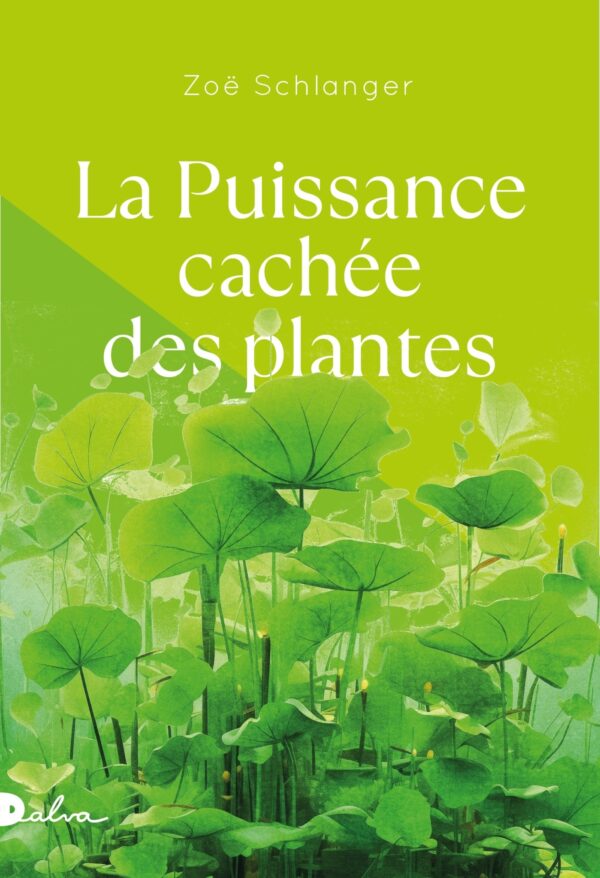La Puissance cachée des plantes
Zoë Schlanger
traduit par Juliette Barbara, Abel Gerschenfeld et Anatole Muchnik

- Document
- 23,50 € | 416 pages
- parution le 3 octobre 2024
- ISBN 978-2-4876-0013-3
Et si, pour mieux penser notre manière d’être au monde, nous sondions la vie végétale ? La nature qui nous entoure révèle des capacités étonnantes : il faut faire preuve d’une créativité sans limite pour survivre et prospérer tout en restant enraciné au même endroit. Des forêts tropicales aux pots de nos salons, les plantes ont appris à communiquer, reconnaître leurs proches, présenter des comportements sociaux, entendre des sons, se transformer, stocker des souvenirs utiles, inciter les animaux à se comporter à leur avantage et développer tant d’autres remarquables talents.
Zoë Schlanger nous embarque dans ses découvertes passionnées, elle convoque la littérature comme ses propres souvenirs et explore les plus récentes avancées scientifiques sur les plantes. Ce texte époustouflant et profondément humain nous ouvre les yeux sur les merveilles de l'écosystème dans lequel nous vivons.

- Revue de presseUne exploration éblouissante où chaque page nous offre d'étourdissantes révélations !Cette enquête très précise mêle les dernières découvertes scientifiques à des observations très personnelles qui permettent de poser sur les plantes et leur rôle dans le monde un regard neuf.Un livre envoûtant, d'une beauté déchirante et qui nous rend le monde plus grand.Un petit bijou de vulgarisation scientifique. Vous ne verrez plus jamais vos plantes de salon ou votre jardin du même œil !Le royaume végétal est riche en mystères et merveilles. Chaque jour, se produisent autour de nous des miracles invisibles que ce livre nous révèle.Que savons-nous exactement des incroyables capacités des plantes ? Pas grand-chose… avant d'avoir lu ce document.Des trésors d'informations sur les plantes que nous côtoyons et finalement connaissons si mal.Un livre doudou. On y découvre que contrairement aux humains, les plantes utilisent leur intelligence à bon escient !
- Maintenant je ne regarde plus ma tondeuse à gazon ou mon sécateur de la même façon. C'est absolument passionnant et c'est une magnifique occasion de tenter de penser le monde autrement même si parfois on risque le vertige. Félicitations au travail de romain qu'ont abattu les trois traducteurs et qui rendent le propos abordable et fluide. Une formidable bouffée d'oxygène et de chlorophylle.C'est époustouflant, complètement bluffant. Nous A-DO-RONS ! Nous vous conseillons de tout cœur ce livre merveilleusement écrit. Il nous a filé une de ces patates.
- Prologue
Je marche le long d’un sentier peu fréquenté. D’épais monticules de mousse ondulent autour de moi. Je lève les yeux, et je me sens toute petite face aux colonnes de bois humides et visqueux qui m’entourent. La terre sous mes pieds est gorgée d’eau, elle a pris de l’ampleur. Un panneau sur le sentier m’indique de faire attention aux élans dans cette zone. Je ne vois pas d’élan, je poursuis mon chemin. Des panaches émergent, des fougères-épées avec leurs crosses enroulées grosses comme un poing de bébé et recouvertes d’une chevelure auburn veloutée, prélude inattendu aux frondes arquées qui jailliront au-dessus d’elles comme des plumes de paon. La mousse s’égoutte en longs doigts depuis les branches qui les surplombent. Du flanc d’un arbre abattu, des champignons s’élancent vers le ciel. Tout semble tendu vers le haut, vers le bas et vers l’extérieur à la fois.
Je m’immisce dans tout cela, mais personne ne me remarque. Chaque élément ici est tellement absorbé par sa propre vie que je demeure aussi imperceptible qu’une fourmi qui se glisse discrètement dans le trou d’une éponge. Les lichens rampant à la base des arbres accueillent le jour – une nouvelle chance de croître –, ils recourbent les bords de leurs feuilles arrondies vers le haut pour capturer les gouttes de rosée.
Je me trouve dans la forêt tropicale de Hoh, dans le nord-ouest du Pacifique, et partout règne un sentiment de secret. Et pour cause. Car ce que la science sait aujourd’hui de ce qui se passe ici sur le plan biologique ne saurait éclipser toutes les choses qu’il lui est encore impossible d’expliquer. Tout autour de moi se trouvent des systèmes adaptatifs complexes. Chaque créature se lie aux créatures environnantes par un assemblage de strates qui se déploie en cascade de la plus grande à la plus petite échelle. Les plantes avec le sol, le sol avec ses microbes, les microbes avec les plantes, les plantes avec les champignons, les champignons avec le sol. Les plantes avec les animaux qui les broutent et les pollinisent. Les plantes entre elles. Tout ce beau désordre défie toute catégorisation.
Je songe concepts de yin et de yang, la philosophie des forces opposées. Nous savons que les forces qui façonnent la vie sont en constante évolution. Le papillon de nuit qui pollinise la fleur est celui qui dévorait ses feuilles lorsqu’il n’était encore qu’une chenille. Il n’est donc pas dans l’intérêt de la plante de détruire complètement les chenilles qui se métamorphoseront en ces mêmes créatures dont elle dépend pour répandre son pollen. Selon la même logique, la plante ne saurait supporter la destruction totale de ses feuilles ; sans elles, elle ne pourrait pas se nourrir de lumière et serait condamnée à mourir. Au bout d’un certain temps, la plante assiégée et déjà partiellement dévorée qui jusque-là a fait preuve d’une grande retenue, commence donc à judicieusement irriguer ses feuilles de produits chimiques peu appétissants. À ce stade, la plupart des chenilles auront mangé suffisamment pour survivre, se métamorphoser et polliniser. Ici, tout le monde passe à un cheveu de la mort pour finalement s’épanouir. C’est le jeu de l’interdépendance et de la concurrence. À grande échelle, personne ne semble avoir encore gagné. Toutes les parties sont encore là, les animaux, les plantes, les champignons, les bactéries. On se retrouve donc face à une sorte d’équilibre en perpétuel mouvement. Et toutes ces poussées, ces tiraillements et ces coalescences, ai-je fini par comprendre, ne sont autre que le signe d’une formidable créativité biologique.
Saisir toute cette complexité demeure le problème commun à la science et à la philosophie, mais aussi à toute personne qui, à un moment donné, s’est arrêté pour réfléchir et s’émerveiller. Réduire notre champ aux seules plantes peut sembler logique à première vue ; cela devrait être plus facile, puisqu’il s’agit de prendre en compte un seul des éléments de toute cette vie en ébullition qui ne s’arrête jamais assez longtemps pour que nous puissions l’observer.
C’est pourtant une conclusion bien naïve. La complexité existe à toutes les échelles.
Dans mon domaine, les journalistes ont tendance à s’intéresser à la mort. Ou à ses signes avant-coureurs : maladie, catastrophe, déclin. Les journalistes spécialisés sur le climat vivent ainsi au diapason des lugubres étapes que la planète franchit l’une après l’autre sur la voie de la crise annoncée. Mais il y a des limites à ce que l’on peut supporter. À moins que ma tolérance n’ait été trop faible et trop facilement éprouvée après des années de focalisation sur les sécheresses et les inondations. Ces derniers mois, j’avais commencé à me sentir engourdie et vide. Or c’est de tout le contraire dont j’avais besoin. Mais qu’est-ce que le contraire de la mort ? La création, peut-être. Un sentiment de débuts plutôt que de fins. Ainsi en va-t-il des plantes, puisqu’elles ont une croissance continue. Toute ma vie elles m’ont apaisée, bien avant que des études ne viennent confirmer ce que nous savions déjà : que le temps passé parmi les plantes peut reposer l’esprit mieux qu’un long sommeil. Dans la grande ville où j’habite, je me promène dans le parc sous une voûte d’ifs et d’ormes lorsque j’ai besoin de me changer les idées et je passe de longues minutes à contempler les nouvelles feuilles qui se forment sur mes philodendrons en pot lorsque j’ai les nerfs à vif. Les plantes sont la définition même du devenir créatif : elles sont en mouvement constant, même au ralenti, sondant l’air et le sol dans une quête incessante d’un avenir vivable.
En ville, elles semblent avoir élu domicile dans les endroits les plus improbables. Elles jaillissent des fissures sur les trottoirs défoncés. Elles grimpent sur les clôtures à mailles losangées au bord de terrains jonchés d’ordures. J’ai contemplé, secrètement ravie, un olivier de Bohême – considéré comme une espèce envahissante aux États-Unis – émerger d’une brèche sur mon perron et atteindre la taille d’un bâtiment de deux étages en une seule saison. Je dis secrètement, parce que je savais que cet arbre était perçu comme une espèce maudite à New York, en partie parce qu’il diffuse des poisons dans le sol autour de ses racines afin d’empêcher toute autre plante de pousser à proximité, s’assurant ainsi sa parcelle de soleil ; et je dis ravie, parce que cela me paraît diablement malin. Lorsque mon voisin l’a abattu à la machette en fin de saison, j’ai compris son geste. Pourtant, je continuais de regarder sa souche avec admiration en sortant tous les matins. Il y poussait déjà de nouvelles protubérances vertes. Chapeau.
Les plantes semblaient donc être le sujet idéal sur lequel porter mon attention usée par l’apocalypse à venir. Elles pourraient certainement me rafraîchir les idées. J’ai vite compris qu’elles feraient bien plus que cela. Au fil d’années d’obsession, les plantes ont transformé ma compréhension du sens de la vie et de ses possibilités. Aujourd’hui, lorsque je contemple la forêt de Hoh, je vois davantage qu’un horizon vert et apaisant. Je vois un cours magistral sur la façon de vivre au maximum de ses possibilités, de ses bizarreries et de ses ressources. Extrait audio de La Puissance cachée des plantes
- Document
- 23,50 € | 416 pages
- parution le 3 octobre 2024
- ISBN 978-2-4876-0013-3
- À la rame
- À Palmares
- Amour, extérieur nuit
- Après la brume
- Biographie sentimentale de l'huître
- Boa
- Carnet de phares
- Chimères tropicales
- Corregidora
- Demi-volée
- Erreur de jugement
- Guérisseuses
- Histoires passagères
- Je suis une île
- L'Enfant rivière
- L'étreinte des ombres
- L'Oiseau rare
- L’Octopus et moi
- La couvée
- La Dent dure
- La Ligne de couleur
- La Sauvagière
- Le délicieux professeur V.
- Le Monsieur
- Le Patriarcat des objets
- Les Animaux de ce pays
- Mer agitée
- Mes hommes
- Nourrices
- Philosophesses
- Pornografilles
- Pussypedia
- Tout le blanc du monde
- Tout le monde sait que ta mère est une sorcière
- Atmosphère
- L'Étrangère
- Pour une résistance oisive
- Trinity, Trinity, Trinity
- Voir tous nos livres